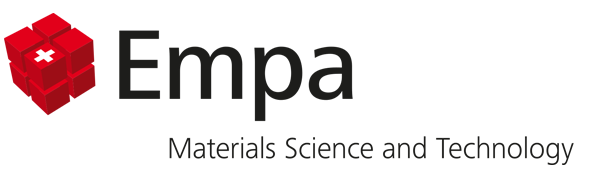Un dialogue sur le nano par delà les frontières interdisciplinaires
Le nano demande que l’on se pose des questions
L’Empa avait lancé une invitation à assister le 23 juin à la première NanoConvention. Près de 200 «nano-intéressés» ont répondu à cette invitation à venir discuter au Kursaal de Berne des «technologies clés du 21 siècle» et de leurs effets sur la science, l’économie, la santé, l’environnent et la société

| Harald Krug, Don Eigler, Louis Schlapbach und Ortwin Renn (d.g.à.d.) | ||
|
«Avec cette NanoConvention nous désirons lancer le dialogue sur le nano en Suisse et cela par delà les frontières entre les disciplines» a déclaré le CEO de l’Empa Louis Schlapbach. «C’est pourquoi il était important pour nous de ne pas avoir à bord uniquement des représentantes et représentants de la recherche suisse qui eux se rencontrent régulièrement. Nous voulions aussi y associer l’industrie, les assurances et le monde de la finance, de la politique, de l’administration et la société en général.» Ce qui a réussi comme l’ont montré non seulement le cercle hétérogène des participants mais aussi surtout les discussions animées et les réactions très positives à cette initiative de l’Empa. «L’Empa doit absolument renouveler cette manifestation» a déclaré par exemple Hans-Joachim Güntherodt, directeur du centre national de compétence «Nanoscale Science» à l’Université de Bâle. Le champ de tension entre les belles promesses des nano-fanatiques et la sinistrose des techno-sceptiques était le thème central de cette NanoConvention. Ou entre «la nano-hystérie du type 1 et la nano-hystérie du type 2» comme l’a exprimé le pionnier de la nano-tech Don Eigler du centre de recherche IBM à Almaden. Pour le type 1, il s’agit d’une exubérance irrationnelle générée par la cupidité – qui sévit entre autres dans l’univers financier; le type 2 se manifeste par une paranoïa tout aussi irrationnelle générée par la peur. «Ces deux maladies qui s’opposent sur le plan psychologique reposent sur un seul et même problème: le manque total de pensée critique» selon Eigler dont le groupe de recherche est parvenu en 1989 à déplacer à l’aide d’un microscope à effet tunnel de leur construction des atomes isolés pour former le sigle «IBM». La nanotechnologie a plus d’une chose à offrir, comme Eigler en est convaincu. «Pour ma part, je crois que le potentiel de la nanotechnologie est colossal.» La nanotechnologie – en termes simples, la manipulation de la matière au niveau moléculaire – permet de créer «sur mesure» des matériaux aux propriétés totalement nouvelles. Les revêtements ultraminces résistant aux griffures, les écrans plats en nanotubes de carbone, les mémoires magnétiques ineffaçables ne sont que quelques-uns des développements qui ont leur origine dans les nanosciences. Ces perspectives de matériaux aux propriétés nouvelles et améliorées obtenus grâce à la nanotechnologie doivent être confrontées aux risques possibles – avant tout ceux pouvant découler des nanoparticules libres. Comment se comportent les nanoparticules dans l’organisme humain? Et dans l’environnement? Et comment le législateur, les employeurs ou tout simplement les consommatrices et les consommateurs doivent-ils se comporter vis-à-vis des nouveaux nanomatériaux? Comment la société réagit-elle à ce défi technologique? Combler le fossé entre la science et la société L’impulsion donnée à la réflexion sur ces questions semble arriver au bon moment car la nanotechnologie en est encore à ses balbutiements. Il existe certes déjà actuellement d’innombrables produits à base de nanoparticules, mais ceci n’est encore qu’un début ainsi que le soulignent les experts. C’est là précisément le bon moment pour identifier et étudier les risques éventuels. Ceci est indispensable pour une utilisation responsable de la nanotechnologie, un avis partagé par tous les participants à cette conférence. Sinon la recherche risque de perdre la confiance de la population. «J’espère que nous autres scientifiques réussirons à mieux communiquer avec la population que cela ne l’a été parfois par le passé» a déclaré Eigler. «Car le fossé entre la science et la société est dans le meilleur des cas inquiétant, et dans le pire, désastreux». Le sociologue Ortwin Renn de l’Université de Stuttgart a mis en garde contre le passage sous silence des risques de la nanotechnologie. «Si la discussion n’est pas menée de manière proactive, ce thème ré-émergera inéluctablement ailleurs. Et alors chargé de demi-vérités comme cela n’a été que trop souvent le cas déjà dans le passé». Pour Don Eigler, le risque de la nanotechnologie réside avant tout dans le fait de l’utiliser sans en évaluer les conséquences. «La diffusion à large échelle de nanoparticules dans l’environnement bien que leurs effets toxicologiques soient inconnus est un tel cas.» D’un autre côté il n’y aura jamais de sécurité absolue – et cela ne vaut pas seulement pour la nanotechnologie. «Il est quasiment impossible de prouver que quelque chose est absolument sûr. Nous devons simplement être des plus prudents et procéder avec prévoyance» déclare Eigler. «La question est la suivante: Comment nous, en tant que société, maîtriserons-nous le défi de la nanotechnologie de façon à ce que nous puissions bénéficier de ses avantages et en même temps en minimiser les risques?» La Suisse ne doit pas perdre le contact Il va sans dire que tant sur le plan scientifique qu’économique, la nanotechnologie est très prometteuse – cela avant tout dans le domaine des sciences de la vie, soit dans les thérapies médicales. Il s’agit d’en profiter aussi en Suisse.- car c’est tout de même là qu’au centre de recherche IBM à Rüschlikon qu’a été développé le microscope à effet tunnel qui est quasiment la clé du nanocosmos. «En Suisse, dans le domaine de la nanotechnologie nous n’avons pas seulement besoin de succès scientifiques mais aussi économiques» a déclaré Christoph Caviezel, directeur de l’agence pour la promotion de l’innovation CTI. La CTI est ainsi prête à promouvoir la nanotechnologie partout où elle le peut. Caviezel nous met en garde de ne pas nous laisser enlever les cartes que nous avons en main: «Il nous fait veiller à ce que nous devions pas finalement pas racheter au prix fort sous forme de savoir-faire technique le savoir de base que nous avons acquis.» Pour Caviezel, le fait que l’élan déclenché par le programme de recherche TOP Nano 21 dans les années 2000 à 2003 s’est éteint est un premier signal d’alarme. En 2003 encore, 93 demandes de financement de projets dans le domaine de la nanotechnologie avaient été soumises à la CTI, une année plus tard elles n’étaient plus que 17. Actuellement des discussions sont en cours entre la CTI et le Fonds national suisse sur un éventuel programme de recherche consécutif. L’urgence d’un tel programme a été reconnue par toutes les personnes présentes à Berne. Hans-Joachim Güntherodt a déclaré à ce sujet: «Il ne suffit pas d’augmenter le nombre des projets. Ce dont nous avons besoin, c’est d’un réseau coordonné». Ce chercheur bâlois envisage un nanoprogramme «auquel tous peuvent participer: l’industrie, les universités, le domaine des EPF et les hautes écoles spécialisées. Ne pas s’attaquer au problème des risques de la nanotechnologie que sur un seul plan La face sombre éventuellel de la nanotechnologie a elle aussi été discutée à la NanoConvention. Dans leurs travaux sur ce thème, les chercheuses et les chercheurs se concentrent actuellement avant tout sur l’étude des particules libres. Harald Hug, toxicologue environnemental au Forschungszentrum Karlsruhe, travaille entre autres sur le transport des nanoparticules dans la cellule. Ses conclusions (provisoires): «Parmi toutes les études effectuées jusqu’ici, aucune ne fournit d’indices que les nanoparticules puissent pénétrer dans l’organisme à travers une peau saine et intacte. La peau fournit une bonne protection contre les nanoparticules.» Mais par contre pas les poumons à travers les quels ces minuscules particules peuvent très bien pénétrer dans le corps humai. Krug pense aussi que l’inhalation des nanoparticules représente le plus grand potentiel de risques pour la santé. A travers les poumons, les nanoparticules peuvent se disperser dans tout le corps, ainsi que le montrent les études réalisées par le groupe de chercheurs réunis autour de Peter Gehr de l’Institut d’anatomie de l’Université de Berne. Les nanoparticules peuvent en effet parvenir dans le sang à travers les cellules épithéliales qui revêtent les poumons et qui assurent l’échange d’oxygène entre l’air respiré et la circulation sanguine. «Les globules rouges les transportent alors vers les organes les plus différents tels que le cerveau, le foie et le cœur», a déclaré Gehr. L’Empa étudie actuellement les effets des différentes nanoparticules sur les cellules dans des cultures cellulaires. Le but de ces travaux est de développer des tests qui permettent d’évaluer rapidement et simplement la toxicité des différentes nanoparticules. Les chercheurs réunis autour d’Arie Bruinink et Peter Wick ont constaté que cette toxicité variait fortement selon les types de nanoparticules. Cette équipe de chercheurs va aussi étudier ce que les nanoparticules toxiques déclenchent exactement dans les cellules. A l’aide de ce que l’on appelle des «puces génétiques» Wick et Bruinink veulent analyser des milliers de gènes pour voir quels sont les programmes génétiques que déclenchent les différentes particules. Une discussion animée a aussi eu lieu sur la manière dont le public perçoit ces risques. Car cette perception des risques dans la société exerce une influence sur les processus d’innovation et est ainsi aussi importante que les risques eux-mêmes. La branche des assurances, qui était entre autres représentée par Swiss Re, ne fait pas non plus de distinction entre les risques effectifs et ce que l’on dénomme les risques perçus. La raison à cela: les risques perçus peuvent occasionner des dommages économiques aussi importants que les «vrais» risques. Raison pour laquelle la branche des assurances adopte souvent une position expectative vis-à-vis des nouvelles technologies. Un besoin de recherche considérable Selon Eva Reinhard de l’OFSP, les lacunes ne concernent pas uniquement les connaissances mais aussi et surtout la réglementation sur les nanoparticules. Actuellement l’usage des nanoparticules est réglementé par la loi sur les produits chimiques. Il faudrait à l’avenir par exemple redéfinir la notion de dose, car la loi sur les produits chimiques n’exige pas d’indications sur la taille, le nombre de particules ni sur leur surface – qui sont des propriétés qui jouent un rôle déterminant pour les nanoparticules et leur réactivité. Eva Reinhard plaide pour un marquage et une identification des produits renfermant des nanoparticules libres. Les thèmes de discussion n’étaient certes pas ce qui a manqué aux participantes et aux participants de cette NanoConvention. Un bon début pour lancer le débat sur le pour et le contre de la nanotechnologie, ainsi que l’estime le directeur de l’Empa Louis Schlapbach. «Ceux qui veulent profiter des chances qu’offre la nanotechnologie – et c’est aussi ce que veut l’Empa – doit acquérir le savoir nécessaire sur son potentiel mais aussi sur ses risques possibles.» Et ceci ne peut se réaliser que dans l’interdisciplinarité, «exactement comme nous l’avons pratiqué lors de cette NanoConvention», a déclaré Schlapbach. Car ce n’est qu’alors que ce savoir pourra être utilisés de manière créative et responsable «pour fournir à l’industrie les innovations dont elle a besoin – et nous assurer à tous une qualité de vie élevée.»
Rédaction: Dr Michael Hagmann, Section Communication, Les photographies de la NanoConvention peuvent être regardées et chargées ici. Vous pouvez aussi les commandez auprès de ou | ||
| |||
| |||